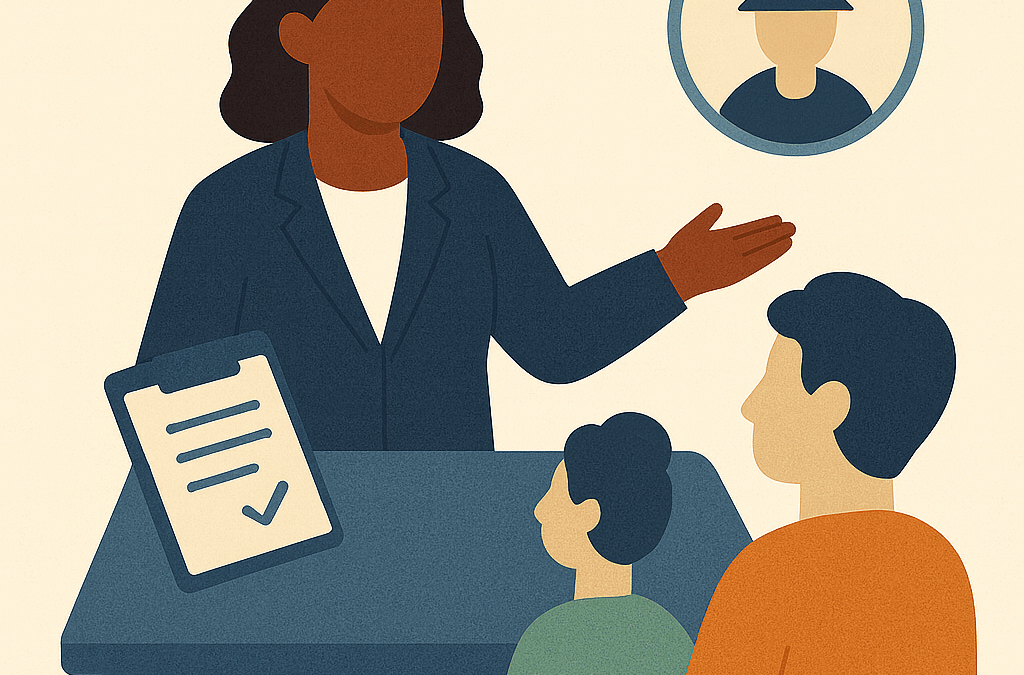L’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) est un dispositif central du droit de la protection de l’enfance en France.
Elle vise à protéger les mineurs en danger tout en maintenant, autant que possible, le lien familial et la stabilité de l’enfant dans son environnement d’origine.
Ce mécanisme, régulièrement réformé et enrichi par la jurisprudence, fait l’objet d’une attention particulière des juges, des professionnels de l’enfance et des familles concernées.
Voici les points essentiels à connaître sur l’AEMO.
1. Qu’est-ce que l’AEMO ? Un principe de maintien de l’enfant dans son milieu
L’AEMO est une mesure judiciaire ordonnée par le juge des enfants lorsque la sécurité, la santé, la moralité ou les conditions d’éducation d’un mineur sont menacées, mais que la situation ne justifie pas un placement en dehors du domicile familial.
L’objectif est de soutenir la famille dans l’exercice de ses responsabilités parentales, d’assurer la protection de l’enfant et de contrôler l’évolution de la situation, tout en évitant la rupture du lien parental.
Le juge privilégie l’AEMO chaque fois que cela est possible, conformément au principe de l’intervention minimale : la séparation de l’enfant et de sa famille doit rester l’exception, la préservation des liens familiaux la règle.
2. Quand et comment l’AEMO est-elle décidée ?
L’AEMO est ordonnée lorsque le juge des enfants constate un danger pour l’enfant dans son environnement mais estime que le maintien dans le milieu familial reste possible avec un accompagnement adapté.
Elle peut être demandée par les parents, le procureur de la République, ou être proposée à la suite d’un signalement des services sociaux.
Le juge des enfants détient une compétence exclusive en la matière.
Il peut ordonner une AEMO même si le juge aux affaires familiales (JAF) a déjà statué sur la résidence de l’enfant, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un fait nouveau.
3. Les objectifs de l’AEMO
L’action éducative en milieu ouvert poursuit trois objectifs principaux :
-
-
- Aide et conseil à la famille : soutenir les parents dans leurs difficultés, qu’elles soient matérielles, éducatives, psychologiques ou sociales ;
- Protection et suivi de l’enfant : veiller à l’évolution et au bien-être du mineur ;
- Contrôle et évaluation : rendre compte périodiquement au juge de l’évolution de la situation et de la pertinence de la mesure.
-
4. Modalités pratiques et durée de l’AEMO
L’AEMO est généralement confiée à un service spécialisé (association agréée, service départemental, etc.).
Les professionnels (éducateurs, assistants sociaux) interviennent au domicile de la famille, proposent un accompagnement personnalisé et travaillent en collaboration avec l’ensemble des acteurs impliqués.
La mesure est ordonnée pour une durée déterminée (généralement inférieure à deux ans), renouvelable si nécessaire, et peut être assortie d’obligations précises (assiduité scolaire, soins médicaux, etc.).
En cas de non-respect de ces obligations ou d’aggravation du danger, le juge peut transformer l’AEMO en mesure de placement.
5. L’AEMO renforcée et hébergement exceptionnel : des dispositifs adaptés
Depuis la loi du 7 février 2022, le juge des enfants peut intensifier ou renforcer l’AEMO si la situation l’exige, pour une durée maximale d’un an renouvelable.
Il peut également, dans certains cas, prévoir un hébergement exceptionnel ou périodique de l’enfant hors du domicile familial.
Ce dispositif d’hébergement temporaire vise à gérer les situations de crise ou à pallier l’indisponibilité ponctuelle des parents, tout en évitant autant que possible le placement de l’enfant dans un cadre institutionnel.
6. Rôle et droits des parents durant l’AEMO
Les parents conservent l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire du juge.
Ils peuvent s’opposer à certaines modalités, notamment en matière d’hébergement exceptionnel, auquel cas le juge est saisi pour trancher.
7. L’enfant, acteur de la procédure : audition et droit d’être entendu
L’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge dans le cadre de la procédure d’assistance éducative, conformément à l’article 388-1 du code civil.
Il peut même saisir lui-même le juge des enfants s’il estime être en danger, dérogeant ainsi au droit commun de l’incapacité du mineur.
8. Garanties procédurales : le principe du contradictoire
La procédure d’assistance éducative est encadrée par de strictes garanties procédurales.
Le principe du contradictoire doit être respecté à chaque étape : consultation du dossier par les parents, droits de la défense, audition de l’enfant, etc.
9. Quelle articulation avec le juge aux affaires familiales ?
Le juge des enfants intervient à titre exceptionnel, ponctuel et provisoire pour protéger l’enfant en situation de danger.
Il ne peut pas modifier durablement les modalités d’exercice de l’autorité parentale fixées par le JAF, sauf survenue d’un fait nouveau de nature à mettre le mineur en danger.
Conclusion : l’AEMO, une solution souple et protectrice
L’assistance éducative en milieu ouvert constitue une réponse adaptée pour protéger l’enfant tout en limitant la rupture familiale.
Elle place l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur du dispositif, tout en respectant les droits des parents.
Les évolutions récentes du droit confortent la souplesse et l’adaptabilité de cette mesure, pour mieux répondre à la diversité des situations familiales, avec un contrôle judiciaire renforcé et un accompagnement professionnel adapté.
Pour toute question, n’hésitez pas à prendre rendez-vous.
© Photo : IA